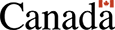LOGOS et la contre culture de Montréal
LOGOS et la contre culture de Montréal
Entrevue avec Paul Kirby et Adriana Kelder, par Louis Rastelli et Alex Taylor
Lorsqu’on s’intéresse aux débuts de la contre-culture et des scènes artistiques underground et activistes à Montréal, on ne peut ignorer l’importance et l’influence du magazine LOGOS. Ce fut la contribution propre de notre ville à la presse indépendante qui émergeait à travers l’Amérique du Nord, au même titre que le Village Voice et le Georgia Straight. Ce milieu de l’édition entièrement nouveau donna une voix à la jeune génération du milieu des années 1960 qui ne voyaient pas leurs préoccupations politiques ou esthétiques reflétées dans le paysage médiatique terne et conservateur de l’époque.
Le présent projet « Montreal Underground Origins » est opéré par ARCMTL, le centre d’archives à but non-lucratif de la culture locale indépendante, qui considère sa série de magazines Logos comme faisant partie de la fondation même de ses collections liées à la culture de l’underground montréalais. Peu de temps après sa fondation en 1998, Archive Montréal a découvert des piles de magazines Logos dans l’arrière-boutique du plus ancien magasin de livres usagés de Montréal (Russell’s sur la rue St- Antoine), juste avant sa démolition qui laissa place à l’expansion du Palais des Congrès. Nichées parmi les piles de journaux du Vieux-Montréal des années 1800 et 1900, tels que Witness, Star et World Wide, les couvertures psychédéliques de Logos ressortaient vraiment du lot, en rupture totale avec tout ce qui était venu avant. Depuis, il est apparu évident que presque toutes les autres publications alternatives, underground ou de la contre-culture parues après Logos à Montréal et au Québec ont été inspirées et influencées de près ou de loin par le magazine.
À l’automne 2015, nous nous sommes assis avec l’éditeur fondateur Paul Kirby et sa partenaire Adriana Kelder à notre centre d’archive pour regarder d’anciens numéros avec eux et parler de la création de Logos et de leur expérience d’avoir vécu à Montréal à cette époque-là. Ce qui suit est une version éditée de la conversation, intercalée avec une transcription de la présentation de Kirby à la conférence d’octobre 2015, Contre-Culture: Existences et persistance à l’Université McGill, ainsi que des portions d’entrevues téléphoniques avec Kirby réalisées par nos collègues du Ghetto Mohawk en décembre 2014 pour leur numéro spécial dédié à Logos, disponible sur leur site Internet.
AK = Adriana Kelder
PK = Paul Kirby
LR = Louis Rastelli
AT = Alex Taylor
LR: Comment vous êtes-vous retrouvés à Montréal en 1966 ?
AK: Je suis allée à l’école à Lakeshore, à Beaconsfield. Je suis née en Hollande; mes parents ont émigré alors que j’avais 8 ans et sont arrivés à Montréal en 1956. J’allais à l’École des Beaux-arts lorsque j’ai rencontré Paul par l’entremise de mon plus vieux frère Robert Kelder, qui a écrit pour Logos. J’étais fraîchement sortie du secondaire quand j’ai commencé l’école des Beaux-arts; je pense que j’avais 19 ans. C’était comme un programme universitaire de 4 ans que je n’ai jamais complété avant de quitter la ville.
LR: Et qu’en est-il pour vous, Paul ?
PK: Je suis arrivé à Montréal autour de ’66. J’étais parti de l’Université de la Colombie-Britannique pour aller en Afrique du Nord, et puis j’ai séjourné à Vancouver avant de m’inscrire aux études supérieures en psychologie à McGill. Je suis devenu si désillusionné par l’étroitesse d’esprit en psychologie à McGill que je me suis lié d’amitié avec le chef du département de philosophie, car j’avais déjà obtenu un diplôme en philosophie. Chandra Prakas était un autre ami, un étudiant à la maîtrise en Littérature anglaise (il a par la suite enseigné longtemps en cinéma au Collège Vanier), il était aussi très impliqué contre la guerre du Vietnam, les droits des Palestiniens et les activités défendant les droits humains à Montréal. On a fait des propositions au gouvernement libéral, nous avons même rencontré quelques ministres pour nous entretenir au sujet de la position du Canada au Vietnam. Nous avons découvert qu’ils s’engageaient envers une cause en public, mais qu’ils se désistaient par la suite de tout type d’engagement. Durant ce processus, nous sommes entrés en contact avec Laurier Lapierre, le journaliste de CBC qui animait l’émission « This hour has seven days». C’était l’une des meilleures émissions de nouvelles à la télévision. Un collègue de la maîtrise, John Grey, était un correspondant—il se peut qu’il ait été impliqué dans le manuel étudiant radical de McGill (que nous avons publié sous le format PDF ici). L’émission fut retirée des ondes car considérée trop radicale. En tout cas, le chef du département de la philo à McGill et moi ont fait venir Noam Chomsky à McGill. Il est venu et a parlé aux départements de psychologie et de philosophie combinés. La conférence fut une incroyable destruction de behaviorisme académique qui regnait depuis 30 ans à McGill!! Et de façon prononcée, les expériences au Allan Memorial avec la CIA. C’était beau à voir.
Nous avons eu un certain nombre de rencontres privées avec Chomsky, lui révélant nos plans consistant à rassembler une poignée d’intellectuels, d’artistes et d’écrivains, et à aller travailler dans les champs du nord du Vietnam. Il m’a immédiatement fait remarquer que ce serait faire un cadeau aux forces américaines, parce qu’elles ne feraient que lâcher quelques bombes et tuer d’un seul coup tous les opposants à la guerre du Vietnam. Il a suggéré plutôt d’ouvrir une auberge pour conscrits réfractaires et résistants de guerre à Montréal, ce qu’on fit. Ça s’appelait la Maison Gandhi, sur St-Antoine au niveau d’Atwater, nous l’avons mis en place en collaboration avec un homme dénommé Nardo Castillo.
Il était un des principaux protagonistes du monde anarchiste espagnol, impliqué dans le Club espagnol et probablement l’enfant d’un anarchiste espagnol de la guerre civile.
Les conscrits réfractaires représentaient en fait une assez petite communauté et, vous savez, c’était difficile à l’époque de trouver des Montréalais anglophones qui étaient contre la guerre. Sur une période d’environ six mois il y avait probablement autour de 100 personnes qui sont venues à Montréal en tant que résistants de guerre. Plusieurs d’entre eux étaient artistes, photographes, designers graphiques, et écrivains qui, pour des raisons variées, venaient au Canada pour résister la guerre ou pour échapper aux griffes du système de conscription.
Nous avons tous réalisé que nous avions cet incroyable bassin de talents et à cette époque, nous souhaitions réellement commencer quelque chose qui puisse déclencher, enflammer tout ce qu’on avait, et ça c’était Logos.
Logos a subi un bon nombre de transformations, mais au début nous croyions réellement aux principes de démocratie participative, et au fait que les choses pouvaient changer si les gens étaient juste rationnels. Nous étions de jeunes idéalistes. À l’époque, Lester Pearson avait réalisé que le Québec était un creuset bouillonnant de soulèvement potentiel alors il a trouvé trois ou quatre intellectuels québécois, l’un d’entre eux était Trudeau, un autre, Marchand et Chrétien et Lapierre…
AK: Et aussi René Lévesque.
PK: Ouais ! Pearson était un gars très intelligent et il souhaitait vraiment coopter le mouvement québécois. Marchand était le ministère nouvellement désigné, fraîchement élu et il a fait un discours quelque part au Canada—un discours très anti-américain—sur la manière dont le Canada devait se retirer de toute implication dans les combats des États-Unis au Vietnam. Alors Chandra et moi avons dit : « Fantastique ! Rencontrez-nous pour le lunch et nous travaillerons avec vous là-dessus ! Vous avez ici deux étudiants des cycles supérieurs et nous nous défoulerons avec vous. »
Nous l’avons effectivement rencontré pour le lunch, et c’était le virage de 180 degrés le plus incroyable. Il avait été foudroyé après son discours par Pearson et quelques autres Libéraux doctrinaires. Il a dit : « Tu ne peux pas t’approcher de ces idées. Nous ne voulons pas dénoncer nos frères du Sud. » Alors Chandra et moi sommes restés tout simplement effarés. C’était un autre de ces pivots où notre naïveté a fait un tour supplémentaire et la roue a tourné un peu plus. C’était l’une des autres raisons pour créer le journal, parce que nous savions qu’au Canada, il n’y avait pas de source de ferveur politique anarchiste nulle part. Les autres journaux étaient plus orientés vers les drogues et la musique, nous nous sommes impliqués dans la musique et le psychédélisme et des choses comme ça mais nous étions toujours en train de pousser l’agenda politique autant que nous le pouvions. Par conséquent, nous étions toujours à risque de nous faire pincer par les autorités!
Je vivais encore dans le Gandhi House lorsque nous avons commencé le journal. C’était énorme, une vieille maison à deux étages infestée de cafards sur St-Antoine.
AK: C’était très ghetto.
PK: Le secteur commençait à être habité par des artistes et écrivains qui se faisaient repousser vers la périphérie. J’ai appris l’existence de l’endroit grâce à un sculpteur qui vivait directement de l’autre côté de la rue. C’était grand, et nous pouvions loger beaucoup de monde, il y avait une immense cuisine. Les conscrits réfractaires et les résistants ne sont pas restés très longtemps, beaucoup d’entre eux se sont installés je suppose dans ce qui est aujourd’hui le Mile-End. C’était bon marché comme pas possible. Nous sommes restés là jusqu’à ce que l’on déménage sur la rue Coloniale.
LR: Est-ce que quelqu’un l’a maintenue après que vous ayez déménagé ?
PK: Je dois dire, je ne pense pas. Chandra n’était pas très impliqué avec le Gandhi House, mais c’est dans le premier numéro de Logos…
C’était le début, à cette époque, de la presse underground. Il y avait le Berkeley Barb, The Village Voice, The LA Free Press, et quelques autres. Nous avons formé un comité de cinq personnes, parmi lesquelles se trouvaient Chandra, Robert, le frère d’Adriana, John Wagner et Alan Shapiro, et nous avons lancé une première édition à l’automne 1967. John était notre artiste de couverture et a réalisé quatre ou cinq couvertures dans les premiers temps du magazine; il est éventuellement allé en Arizona pour se concentrer sur son art. Chandra est lui aussi devenu moins impliqué, puisqu’il faisait son Doctorat. Pendant ce temps, j’avais quitté McGill, alors le projet de journal est tombé dans les mains de Robert et moi-même.
Tout de suite après le premier numéro, nous avons acquis un loft au 3666 Saint-Laurent, au-dessus d’une boulangerie. Je pense que nous avons sorti trois ou quatre numéros à partir de ce loft, et puis nous avons loué un duplex au coin de Coloniale et Prince-Arthur, juste à côté d’une poissonnerie. Nous avions le bureau dans le sous-sol et des logements sur les autres étages. C’était la première fois que nous emménagions tous ensemble, alors c’est devenu connu comme la Maison Logos.
AT: (feuilletant les pages du premier numéro de Logos) Il y a une publicité de Le Château à l’intérieur.
PK: C’est drôle que vous mentionniez cette publicité. J’ai passé deux ou trois jours, sinon des semaines, à marcher dans les rues de Montréal, allant à différents endroits et disant : « Nous lançons un journal ou magazine underground parlant des arts et de la politique, aimeriez-vous y faire de la publicité ? » Et voilà que, à Le Château, qui était l’un des magasins sur la rue Ste-Catherine, j’ai vu ce beau manteau dans leur vitrine, et je me suis retrouvé à l’avoir en échange pour une publicité.
Il y a une publicité pour le magazine appelé Take One. Je suis rentré dans leur bureau, ils venaient tout juste de commencer, et j’y suis entré là sans aucune idée de ce que c’était et j’ai fait un pitch au gars. Il avait ce sourire très particulier sur son visage et il dit finalement : « Savez-vous ce qu’on fait ? » et j’ai dit : « Pas vraiment, mais j’aimerais avoir votre publicité dans notre journal. » Et il sourit et dit : « OK, je le ferai ! » Et il a écrit un chèque pour cinquante dollars ou quelque chose comme ça. C’était un magazine de cinéma.
Aucun d’entre nous n’avait de grands desseins. Nous vendions le journal, et nous vendions les publicités, mais nous n’avons jamais pensé que le journal deviendrait un succès commercial de longue haleine.
LR: Était-ce rentable au début ou du moins couvriez-vous vos coûts ?
PK: Nos coûts d’impression étaient si minimes.
LR: Vous connaissiez déjà probablement certaines entreprises qui achetaient des publicités, le New Penelope par exemple, et d’autres que vous voyiez juste en vous promenant.
PK: J’aurais pu avoir rencontré le gars du New Penelope [GARY EISENKRAFT] en assemblant ce premier numéro-là. Nous avons en fait commencé une université gratuite ensemble à travers le journal et je ne sais pas ce qui s’est passé avec ça.
LR: Est-ce que le Café Prag était un endroit où vous alliez ?
PK: Café Prag était là où toi [ADRIANA] et moi allions souper, avec le pudding à la vanille.
AK: (rires) [REGARDANT LE NUMÉRO DE LOGOS] Ça c’est quelqu’un qu’on a perdu de vue, Allan Shapiro. C’était un Américain. Il est allé à Paris et s’est impliqué dans la révolte étudiante…
PK: En ’68. Il nous a appelé de l’ambassade américaine et il était à Prague et Berlin et puis nous avons perdu sa trace… c’était soit le second ou troisième numéro.
LR: Combien de personnes y avait-il dans l’équipe du Logos alors ?
PK: À ce point-là, si vous considériez la genre de « famille », il y avait probablement quelque chose comme 20-25, et nous disions toujours aux monde : « Prenez le journal et essayez de le vendre et si vous pouvez ramener un certain montant d’argent, c’est bien, » mais ce n’était jamais notre intention de faire de l’argent. Je n’ai aucune espèce d’idée de comment on se nourrissait.
AT: La publicité couvrait-elle l’impression du journal ?
PK: Ça devait être le cas parce qu’il y avait un imprimeur –le même imprimeur pour toute la durée de vie du journal…
LR: Était-ce le même imprimeur que ce magazine Midnight, par hasard ? Le format et le type de papier sont assez identiques.
AK: Certaines des personnes qui ont écrit pour nous ont aussi travaillé à Midnight.
PK: L’un d’entre eux était d’Angleterre, et il y avait un autre gars qui a publié tous ces journaux, il y en avait 8 environ, je pense. Il avait un bureau, et chaque journal avait un pupitre et une personne assignée, et tout ce qu’ils faisaient était d’en produire le plus possible !
LR: Les illustrations que ça donnait, elles étaient assez intéressantes et très belles. Devaient-ils les dessiner et de cette taille là et vous amener les originaux ?
PK: Nous travaillions toujours avec 20% de réduction. Nous faisions toutes œuvres artistiques originales, collions le tout—dépensions un temps fou à justifier toutes ces colonnes—et nous avions ces machines à écrire IBM Selectric. Nous avions une personne en charge du design et de la mise en page en plus de moi-même, puis nous apportions toutes les pages à l’imprimeur et il les photographiait tout simplement et brûlait les plaques et faisait sortir le journal.
LR: Avez-vous fait autour de 10 000 copies ?