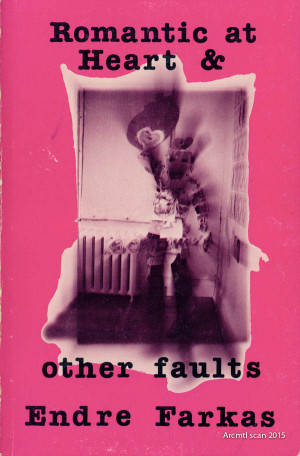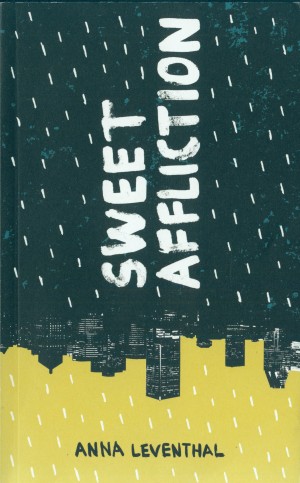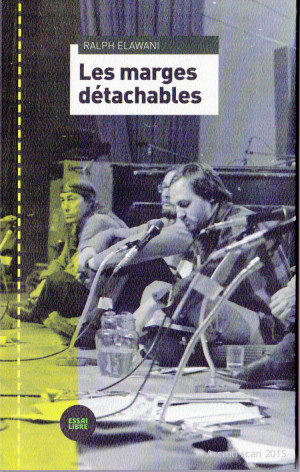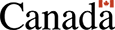METROPOLIS BLEU : MONTRÉAL dans l’IMAGINAIRE, 1975 / 2015
METROPOLIS BLEU : MONTRÉAL dans l’IMAGINAIRE, 1975 / 2015
Une table ronde tenue le vendredi 24 avril dans le cadre du festival international littéraire Métropolis Bleu à Montréal. Les participants étaient les écrivains Endre Farkas, Anna Leventhal et Ralph Elawani. La discussion était modérée par Bryan Demchinsky.
BD : Bryan Demchinsky
EF : Endre Farkas
AL : Anna Leventhal
RE : Ralph Elawani
BD : Nous allons faire un avant / après littéraire. Imaginez-vous être un écrivain à Montréal dans le milieu des années 1970, en 1975, en train d’écrire. Comment est la ville? Puis, imaginez-vous à nouveau être un écrivain à Montréal aujourd’hui. Comment est-ce que les choses ont changé? Comment est-ce que les choses ont évolué dans le paysage littéraire?
Quant à moi, j’ai raté les années 1970 à Montréal. Je suis arrivée ici en 1982, et comme beaucoup de gens qui sont venus ici avant moi et tant depuis, je suis tombé amoureux avec la ville. C’est ici que j’ai voulu prendre racine.
Je suis venu ici comme journaliste et je travaillais à The Gazette. Je n’étais pas familier avec la scène littéraire, mais un an après mon arrivée, on m’a invité à une réception chez Simon Dardick, l’éditeur de Véhicule Press, et je me suis soudainement retrouvé seul dans une pièce avec Louis Dudek, F.R. Scott et Irving Layton et — même si je n’étais pas vraiment dans la scène littéraire, je savais que j’étais en présence de grandeur, et que c’était un moment très spécial. D’autant plus qu’il s’est avéré que F.R. Scott décéda quelques mois plus tard.
À l’époque, un changement de générations était en cours sur la scène littéraire. On passait des gens comme ceux qui étaient dans cette pièce et d’autres écrivains emblématiques, comme Mordecai Richler et Leonard Cohen, par exemple, qui étaient alors à leur apogée. Je pense qu’ils quittaient Montréal pour diverses raisons et que la ville qu’ils connaissaient et qu’ils avaient en quelque sorte créée dans leurs écrits changeait.
Par exemple, Leonard Cohen est parti et est devenu plus connu pour sa musique. Richler, quant à lui, est allé habiter dans d’autres parties du pays avant de revenir ici. Une indication qui pourrait expliquer cela se trouve dans son roman de 1970 St. Urbain’s Horseman, où l’un de ses personnages dit : « C’est nulle part Saint-Urbain, nous ne sommes rien ici. Nous sommes mieux de partir. »
Je pense que c’est effectivement ce qu’il a fait et ce que d’autres ont fait d’une façon ou d’une autre, à l’exception de Irving Layton, bien sûr, car son ego était plus grand que tout Montréal de sorte qu’il lui importait peu où il vivait. (La foule rit.)
Les changements à Montréal découlaient en partie des changements qui se passaient au Québec à l’époque, soit les suites de la Révolution tranquille et de la crise d’octobre. Les écrivains francophones comme Michel Tremblay et Yves Beauchemin pouvaient écrire des romans qui rendaient compte pleinement de Montréal dans la littérature. Pendant ce temps, du côté anglo, William Weintraub écrivait The Underdogs, ce roman dystopique dans lequel il décrit une Montréal décrépite qui est l’ombre d’elle-même et qui est dirigée par un gouvernement nationaliste autoritaire.
Mais je pense que cela importait moins à la génération plus jeune, les baby-boomers et le monde de la contre-culture, de sorte que c’est là que j’aimerais débuter avec Endre afin de connaître ses impressions et afin qu’il nous parle de ce qu’il a vu à cette époque.
EF : Un tout petit point au sujet des auteurs qui quittaient… les prosateurs sont partis, les poètes sont restés. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Je suis arrivé en 1956, mes parents ont fui la Hongrie et nous nous sommes installés sur l’avenue du Parc, près de Fairmount, qui est aujourd’hui l’endroit à la mode où l’on doit être vu, mais nous étions là quand ce n’était pas le cas.
Ce que j’aimerais faire est de simplement vous lire une lettre que j’ai écrite à Abraham Moses Klein (A.M. Klein). Il était déjà mort, mais dans ce temps-là, les poètes s’écrivaient entre eux tout le temps. Dans un sens, ceci est une lettre de poète à poète d’une génération à une autre que je vous partage pour vous donner une idée de Montréal à l’époque.
« Cher Abraham, il est tard, mais pour nous, c’est le bon moment pour être éveillé, voler du temps au sommeil et songer au sort et à la foi impliqués dans ce qu’est de vivre dans cet endroit. Moi aussi, je suis un immigrant et comme vous, sais ce que c’est que d’être à l’intérieur, à l’extérieur. Peu a changé depuis, comme enfant, vous avez tenu la main de votre père en route vers et depuis la synagogue. Chaque jour de sabbat, comme jeune homme, tenir la main de votre dulcinée en route vers et depuis les promenades sur la montagne les soirs d’été. Comme père, tenir la main de vos enfants en route vers et depuis une promenade à travers Fletcher’ s Field. En tant que poète, mains dans les poches, errant à travers les rues de votre ghetto, votre terre d’exil, votre labyrinthe.
Oui, il y a encore toutes ces choses pour les nouveaux arrivants, il y a toujours de nouveaux arrivants. Ça en dit long sur notre monde. Mais ces nouveaux venus rachètent ces taudis vides de propriétaires et les rénovent en les peinturant bleu grec, vert portugais, rose gai et toutes les autres couleurs des immigrants. Ils font une maison de ces rues de ghetto. Et vos petits-enfants dont les parents ont travaillé si fort afin d’échapper à vos rues St-Urbain, de Bullion, Hôtel de Ville, Marie-Anne et Rachel, reviennent, essayant de racheter ces appartements infestés de cafards. Mais crois-le ou non, ils ne peuvent pas se le permettre. Abraham, votre ghetto est devenu très chic. La montagne est toujours là, mais vous risquez votre vie pour l’atteindre.
De même pour cette femme monumentale aux seins cuivrés ternis à qui vous lanciez les cailloux de l’école buissonnière. Elle est toujours là, recevant toujours l’attention des cailloux des enfants, avec le même stoïcisme. Elle nous survivra tous. Et les dimanches après-midis d’été, la fatigue du monde, qui est beaucoup trop avec nous, est aspirée. Et bien sûr, il y a les amoureux parmi les buissons, avides et maladroits sur leur lit épineux, et il y a des garçons qui appelleraient des filles, et des filles appelleraient à l’affront. La montagne est encore une inspiration, elle est le principe féminin dans cette ville macho. La manière qu’elle touche, la manière qu’elle réconforte. J’ai passé des nuits perdues dans sa verdure, blotti contre ses seins. Et même si violée par les gratte-ciels, son esprit n’est pas brisé. Elle est toujours magique.
Les élections municipales approchent. C’est le seul moment où ce maire rampe hors de son trou luxueux, c’est vrai qu’il ressemble à une taupe, Jean Drapeau. Rêve d’être roi, mais est devenu une reine vieillissante qui a donné naissance au déficit et à des difformités. Ce n’est pas un cadeau. Bon Jean a été élu sur la promesse de faire de Montréal une femme honnête. Il semble réussir. Comme un proxénète, il l’a fait travailler fort, l’a vidée, l’a rendue laide et stérile.
Mais nous ripostons et continuons de cartographier sa géographie sacrée. Nous faisons l’amour avec elle dans les moments insoupçonnés, après que le métro ait cessé, dans les ruelles oubliées, chambres louées, bars et cafés, après les heures légales, de toutes sortes de façons. Et comme pour la province : la chaise berçante, sauf pour les antiquaires, n’est plus le véhicule. Il y a très peu de temps au 20e siècle pour s’asseoir sur les balcons, bien que les chômeurs le fassent et leur nombre augmente.
Les Anglos du pouvoir sont encore dans les pentagones de Washington et les chambres fortes de New York, leurs directeurs de succursales poussent des pancartes « à louer » comme des vivaces parce que les anciens Canadiens de la Belle Province sont devenus Gens du pays. Ils trouvent leur domaine provincial trop étroit et ne veulent plus les vieux habits des autres. Je leur souhaite bon succès. Pourtant, je sais bien que s’ils réussissent, je serai à nouveau en exil.
Je vous le dis, Abraham, pour nous il n’y a qu’une seule nation : l’imagination. Et pour cette raison, nous serons toujours en exil. Oh, Abraham! Souvent, tard la nuit, en me promenant sur des rues familières, je regarde les fenêtres éclairées et aperçois des figures priant dans le vrai langage de l’esprit de ce lieu. Écris bientôt. »
(Applaudissements.)
BD : Permettez-moi de commencer par vous, Endre. Est-ce que vous croyez que les changements qu’a vu Montréal dans les 40 dernières années, tant sur le plan physique que social, ont affectés la culture littéraire d’ici?
EF : Eh bien, tout d’abord, dans les années 1970, quand j’ai commencé à participer dans la scène littéraire, la ville était essentiellement une cité de poètes. Les prosateurs sont partis parce qu’ils sentaient qu’ils ne pouvaient pas travailler ici. Les poètes sont restés probablement parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre de partir. Même la meilleure collection de poèmes, sauf peut-être si vous étiez Leonard Cohen, ne vous achetait pas des mois en Grèce ni ailleurs. Montréal était une ville abordable, j’ai entendu maintes et maintes fois que Montréal était une ville abordable et que c’est pourquoi les artistes ont tendance à vivre ici. Voilà l’un des aspects.
Lorsque j’ai débuté dans la scène, c’était autour du centre d’artistes Véhicule. Elle avait été ouverte par des artistes visuels qui étaient en train de terminer leurs études ou qui étaient déjà diplômés de Concordia, principalement, et qui n’étaient pas exposés parce que leur travail était non conventionnel.
Il y avait un groupe de poètes : les poètes de Véhicule. J’étais l’un d’eux. Ce n’est pas nous qui avions inventé notre nom, c’était d’autres gens qui nous appelaient ainsi, de façon péjorative. C’est nous qui avions en quelque sorte revigorée la scène littéraire, comme l’a mentionné Bryan. Cohen était parti, Irving Layton et Richler étaient également partis. Le groupe qui a suivi après ça, on les appelait les « clones de Cohen », ils faisaient des trucs assez classiques qui ne nous intéressaient pas. Nous, on essayait plein de choses différentes. Montréal était un endroit qui était suffisamment libre pour tout essayer au moins une fois. Il n’y avait pas de quartiers branchés où vivre; il y avait seulement plein d’endroits pas chers, pour manger et pour boire aussi. Les gens se rassemblaient pour discuter, pas tant de politique comme les Francophones parce que ça, c’était une des choses qui était évidentes. Les écrivains de la communauté anglophone n’ont pas ou ne pouvaient pas parler de ce qui se passait. Les seuls qui l’on fait étaient les poètes de Véhicule.
C’était à une époque où Concordia invitait des gens de renom et quelques poètes de second ordre des États-Unis pour venir faire des lectures. George Bowering a commencé à inviter de bons poètes canadiens comme David McFadden, Michael Ondaatje, et nous avons fait de même à Véhicule. Simon Dardick avait demandé à ceux d’entre nous qui organisaient des lectures à la galerie Véhicule si nous étions intéressés à lancer une presse. Nous avons dit : pourquoi pas. Nous avons donc commencé à publier des gens, qui d’une certaine manière en ont frustré plusieurs qui ont lancé leurs propres presses. Guernica en était un, Delta Canada s’est en quelque sorte réveillé, et puis c’est rapidement devenu une scène dynamique.
En ce qui concerne les médias, ce n’était pas terrible. The Montreal Star avait un critique qui considérait tout ce qui était arrivé après le Moyen Âge comme sans valeur. La section des livres n’était pas intéressée par les choses locales jusqu’à ce que Tom Konyves commence à couvrir le sujet occasionnellement. Ce que je veux dire est que les années 1970 étaient comme la fin d’une période et le début d’une autre et je pense que c’est de là qu’ont découlées les scènes plus vivantes qui sont apparues plus tard.
BD : Et il est intéressant de noter que les deux presses, Guernica et Véhicule, existent encore aujourd’hui, Véhicule à Montréal et Guernica en Ontario. Ralph, pourriez-vous décrire vos impressions par rapport à cette période que vous avez étudiée et parler de comment les choses ont évolué depuis?
RE : Une chose certaine à mon avis, que tu as également mentionné à propos de la ville, est la façon dont beaucoup d’écrivains et de poètes anglophones ont perçu d’une façon romancée la ville. C’est un regard amoureux sur la ville, malgré toutes les tensions qu’il pouvait y avoir.
BD : Mais tout au long de cette période, Montréal fut un objet de…
RE :… fascination
BD : Fascination, oui, et de considération, dans les écrits des gens.
AL : Pourrais-je intervenir? Se pourrait-il que ce fût deux cultures parallèles et deux solitudes, mais tout aussi vivantes et maintenant ce que nous voyons est beaucoup plus une appréciation et peut-être encore deux solitudes, mais d’une manière différente… ?
BD : Je pense que c’est un point important et nous allons y revenir.
RE : C’est un bon point et si vous regardez des films de l’époque, si vous pensez à Le Chat dans le sac et quelque chose comme The Ernie Game, les deux films décrivent différentes scènes artistiques, mais tous deux sont parallèles l’une à l’autre. C’est un exemple frappant. Même des gens comme Robin Spry, qui a fait un film merveilleux à propos d’octobre 1970, étaient fascinés par ce milieu, même s’il était issu d’un milieu complètement différent.
BD : Permettez-moi de lancer ceci, c’est une question sur un sujet connexe. Y avait-il des quartiers, ou y a-t-il des quartiers aujourd’hui, plus propices aux écrivains pour établir leur nid?
AL : Quand nous parlons des écrivains et des quartiers, je me demande parfois si nous sommes en fait en train de parler d’immobilier et d’embourgeoisement. C’est parfois difficile de les distinguer. Vous savez, nous parlons des quartiers émergents qui sont abordables et ce sont souvent des quartiers traditionnellement habités par des gens de la classe ouvrière et de nouveaux arrivants et puis, ces quartiers deviennent des foyers d’activité artistique, puis ils attirent une certaine catégorie démographique, puis ils deviennent embourgeoisés et ça devient hors de prix pour les habitants. Je pense que nous pourrions voir ce phénomène dans toutes les décennies ou à peu près.
BD : Mais je pense qu’Endre, vous disiez que c’était moins le cas à l’époque.
EF : Oui. Au début des années 1970, il y avait The Word Bookstore sur Milton dans le ghetto McGill. C’était un endroit pas cher où les écrivains se rassemblaient, mais ils venaient de tous les coins de la ville. Je sais que beaucoup d’artistes en arts visuels habitaient sur le boulevard Saint-Laurent au-dessus des magasins près de Dorchester, maintenant René-Lévesque. Je prenais un autobus sur Dorchester, maintenant René-Lévesque, et le chauffeur disait : « Atwater, à l’eau! Guy, Guy! YWCA, Young women come again ! ». Il faisait son petit spectacle, bilingue. Montréal était un peu n’importe quoi.
Beaucoup d’artistes vivaient dans le ghetto. Le ghetto McGill était à peu près l’endroit le moins cher. À l’époque, Esplanade était encore plus immigrante, St-Urbain, Esplanade, Jeanne-Mance, tous les Hassidiques, les immigrants des années 1950 et des années 1940… À ce moment-là, les appartements étaient grands, alors de grandes familles pouvaient y vivre.
Et comparé à aujourd’hui, il n’y avait pas tant d’écrivains ou d’artistes qui vivaient à Montréal. Ce sont les artistes qui ont déménagé ici pour la scène musicale et pour la scène des jeux vidéo qui ont grossi au point où ils en sont venus à occuper toute une zone et à pouvoir la revendiquer comme la leur.
À l’époque, Montréal, ou du moins les zones que nous connaissions, étaient ce que je pourrais appeler « authentiques », dans la mesure où ces endroits ne se considéraient pas à la mode parce qu’ils n’étaient pas conscients de ce qu’ils étaient. Ils se trouvaient là, tout simplement. Et les artistes se trouvaient un peu partout, mais avaient tendance à se rassembler dans les cafés comme Le Café Prag ou The Yellow Door, un autre endroit pour les musiciens et les poètes. Donc ce n’était pas tant une question de quartier comme tel, qu’une question d’où se trouvaient certains gens et divers endroits clés spécifiques à travers la ville.
RE : En même temps, c’était très central ; je suis sûr que personne n’a jamais entendu parler de la scène de poésie Beat de Baie-D’Urfé ou de la scène punk rock d’Ahuntsic ou peu importe. Ces secteurs que vous mentionnez comme le ghetto McGill, St-Urbain, ont joué un rôle central et étaient essentiellement des lieux où les gens se sont rassemblés pour des raisons évidentes : proximité du centre-ville, logement abordable à l’époque… (le cinéaste et écrivain) Emmanuel Cocke avait l’habitude de vivre dans le ghetto McGill avec des gars comme Louis Geoffroy et s’est mélangé – d’après ce que je comprends – à des personnes comme Claude Péloquin qui était un grand admirateur de Louis Dudek.
EF : Oui.
BD : Vous m’offrez une opportunité de transition pour ma prochaine question. Pensez-vous qu’il y a autant ou davantage de solidarité entre écrivains francophones et anglophones aujourd’hui? Ou combien il y en avait-il à l’époque, Endre?
EF : Je peux parler par expérience. Dans les années 1970, quand j’organisais la série de lectures à Véhicule, même si Véhicule avait un accent aigu, c’était principalement anglophone, mais j’ai essayé de tendre la main. Dans les arts visuels, il y avait plus d’entrecroisements. Le milieu de la danse était très mélangé parce que tu n’avais pas à parler, juste à bouger.
Mais j’ai tenté de mettre sur pied une série où poètes francophones et anglophones feraient leurs lectures dans une même soirée. Je me souviens d’avoir eu une conversation avec Gaëtan Dostie, qui était un Québécois affirmé — il avait mis sa photo d’arrestation sur la couverture de son premier recueil de poésie et il m’avait dit : Endre, je t’aime, mais pas politique de même. En voulant dire : si tu veux, donnes-nous les lectures et on va s’arranger avec, mais il faut que ce soit en français seulement. Et je dis : désolé, il n’y aura pas ce genre de séparation.
Donc, nous avons essayé, mais plus tard, dans les années 1980, avec Lucien Francoeur. Nous avons fait une série de petits magazines appelés Montréal Now, où la moitié des poèmes était en anglais et l’autre moitié en français. Pour chaque publication, on organisait un truc et on avait une lecture quelque part. Mais après la lecture, ils allaient de leur côté et nous, du nôtre. Donc, il y avait encore cette séparation. Il n’y avait pas d’animosité en soi, mais nous avions réalisé que nous étions, je ne sais pas si c’est deux solitudes, mais deux langages différents.
RE : C’est drôle que vous mentionniez Gaëtan Dostie parce qu’en 1975, alors que Montréal accueillait la Semaine de la Contre-Culture, c’était la scène francophone qui a amené William Burroughs, Allen Ginsberg, et tous ces gens des États-Unis et d’autres d’Europe. C’est drôle parce que Gaëtan me disait qu’il avait reçu Burroughs et Ginsberg chez lui pour manger de la dinde et je me demandais pourquoi…
EF : Ils étaient Américains; ils étaient prêts à avoir du bon temps avec eux. Michel Tremblay a également été très clair quand il a dit qu’il n’avait aucun problème avec le fait que ses livres se fassent traduire et publier en anglais hors du Québec. Et ils avaient un lien à travers les poètes Beat avec Kerouac (qui était originaire du Québec).
RE : Je veux dire, même des magazines comme Logos, leur premier numéro était bilingue. Les racines de la contre-culture à Montréal sont du côté anglo et puis se sont propagés plus tard sur le côté francophone avec des magazines comme Mainmise et des trucs comme ça, mais l’ennemi à l’époque n’était pas tant la langue que l’État ou les pouvoirs établis sous le poids duquel les gens se sentaient écrasés. Malheureusement, les autorités avaient une langue que l’on pouvait leur rattacher…
EF : Eh bien, les écrivains, sauf peut-être pour Louis et Richler, compatissaient avec les Québécois et leurs aspirations. Ils n’étaient pas particulièrement friands de la façon que ça avait été mené, mais ils comprenaient. Je pense que c’est en partie pourquoi la communauté d’écrivains anglophones préférait ne pas en parler. D’une part, la culture littéraire anglophone n’avait pas de lien avec la culture d’entreprise anglophone, alors que les écrivains francophones avaient des liens interconnectés très forts avec leur propre peuple.
RE : Par leur propre peuple, vous voulez dire Québécois ou…?
EF : Oui, Québécois. Ce que Yvon Deschamps disait, ce que Charlebois chantait, ce que Gaston Miron écrivait… ils étaient connectés à la racine.
BD : Anna, j’aimerais entendre votre point de vue en tant qu’arrivante plus récente et si vous voyez ce problème de solidarité et comment il apparaît à vos yeux.
AL : Oui, j’ai bien l’impression qu’il y a un assez grand écart entre les communautés littéraires francophones et anglophones, mais il y a aussi des gens, comme les traducteurs qui comme Mercure, font les messagers entre les deux mondes et je pense que c’est quelque chose qui commence à avoir plus de… en fait, non, ce n’est pas vrai. Il y a toujours eu des gens qui ont fait de la traduction, alors je ne sais pas… Je pense qu’il est intéressant de réfléchir à ce que les différentes générations d’écrivains considèrent comme les sujets chauds et ce à quoi ils ripostent, surtout quand on parle de contre-culture. En ce sens, je pense qu’à certains égards, on pourrait dire que les deux communautés linguistiques sont souvent unies, comme dans les années 1970, après la Crise d’octobre, où il y avait le sentiment d’un gouvernement militarisé qui arrêterait n’importe qui pour un oui ou pour un non. Je pense que les deux communautés se sont mobilisées pour cela, ce qui est très similaire à aujourd’hui, lorsqu’on regarde le Printemps Érable ou le mouvement étudiant contre l’austérité. Je ne suis pas certaine si je peux appeler ça deux cultures, mais franchir le fossé qui sépare les deux langues et aussi, bien sûr, nous ne parlons pas vraiment des gens qui ne sont ni de culture francophone, ni de culture anglophone, soit les allophones. Il y a donc maintenant une culture de troisième langue et je pense que la Charte des valeurs a été un enjeu majeur qui a mobilisé beaucoup d’écrivains, a suscité beaucoup de critiques et qui va ressurgir dans les écrits des jeunes Montréalais pour un temps.
BD : Quels sont les défis aujourd’hui, par rapport à ce qu’ils étaient avant, pour les écrivains qui sont soit débutants ou peut-être même en milieu de carrière, étant donné les énormes changements que nous avons pu observés dans la dernière décennie ou deux? Nous allons commencer par le passé parce que je suis sûr qu’il y avait des défis, comme par exemple que la scène littéraire canadienne n’était pas aussi bien établie qu’elle ne l’est devenue.
EF : Je me souviens d’avoir travaillé sur des machines à polycopier et des machines à écrire. Quand nous avons eu des machines à écrire électriques, nous avons pensé : « wow! Ça, c’est de la technologie de pointe! » Donc nos moyens pour rejoindre le public étaient : tu polycopiais entre 50 et 60 affiches et tu marchais à travers la ville pour les agrafer sur quelque chose ou tu les laissais aux librairies Word Bookstore, Paragraphe ou Argo et puis tu comptais sur le bouche-à-oreille et finalement, les gens se présentaient.
À Montréal maintenant… Je ne pense pas que les artistes entrevoient être ici comme une sorte de limitation ou de barrière à être ailleurs, car ils peuvent envoyer leurs trucs à travers le monde entier ; alors qu’avant, les scènes locales s’élargissaient en scènes régionales. Vous aviez la scène de la Colombie-Britannique, celle des Prairies, la scène de l’Ontario que tout le monde détestait (la foule rit) et vous aviez la scène du Québec et celle des Maritimes dont tout le monde ignorait l’existence. Mais il y avait des occasions où un écrivain voyageait grâce à une subvention du Conseil des Arts et quelqu’un vous invitait quelque part et vous y alliez. C’était de cette façon que les nouvelles se répandaient, comme une tradition orale. Les gens demandaient ce qui se passait à Montréal, ce qui se passait à Toronto, qui faisait quoi… Puis vous finissiez par inviter quelqu’un à votre tour et c’est comme ça que la communication se faisait, et comment ce que les gens écrivaient influençait le développement de la langue. Quand je pense à aujourd’hui, ça se faisait à une vitesse de tortue, mais peut-être que ça formait une identité régionale, chose qui n’existe plus. C’est davantage un village global qu’un village local.
AL : Je dirais plutôt que ça donne aux gens un plus grand sentiment d’appartenance. Les gens passent tellement de temps sur Internet, un genre de non-lieu, que je crois que les gens cherchent avidement à faire un travail qui leur redonnerait un sens du lieu, que ce lieu leur soit familier ou non. Du moins, c’est mon expérience.
BD : J’aimerais ajouter quelque chose à ce point, quelque chose dont Louis et moi avons discuté en vue de cet événement. Oui, la scène littéraire montréalaise se porte mieux que jamais avec tout ce qui se passe ici, c’est juste qu’il n’y a plus autant de mobilité qu’avant. Je pense que cette évaluation est juste en raison des difficultés liées à se faire publier et à trouver un éditeur national et ainsi de suite.
ED : J’étais en Slovénie récemment et j’ai passé une nuit à écouter des écrivains se plaindre qu’ils ne pouvaient pas obtenir de subventions, ni d’argent, ni d’attention et que leur travail ne se faisait pas traduire, de sorte qu’ils ne pouvaient pas rejoindre les lecteurs et lectrices anglophones. Les poètes expliquaient qu’ils devaient imprimer 100 exemplaires de leurs publications eux-mêmes et je leur ai dit : « bien, ça c’est une tradition honorable! »